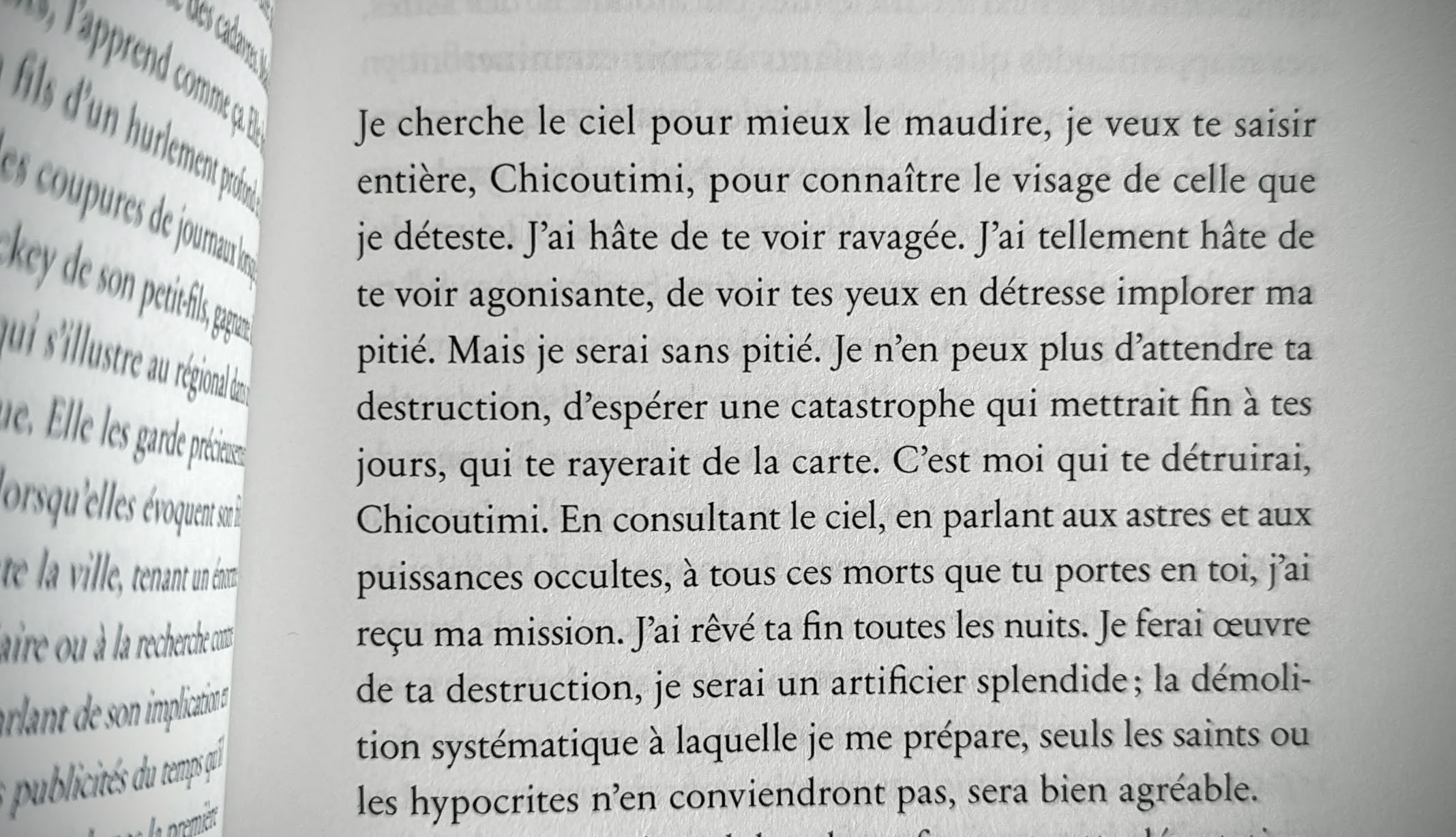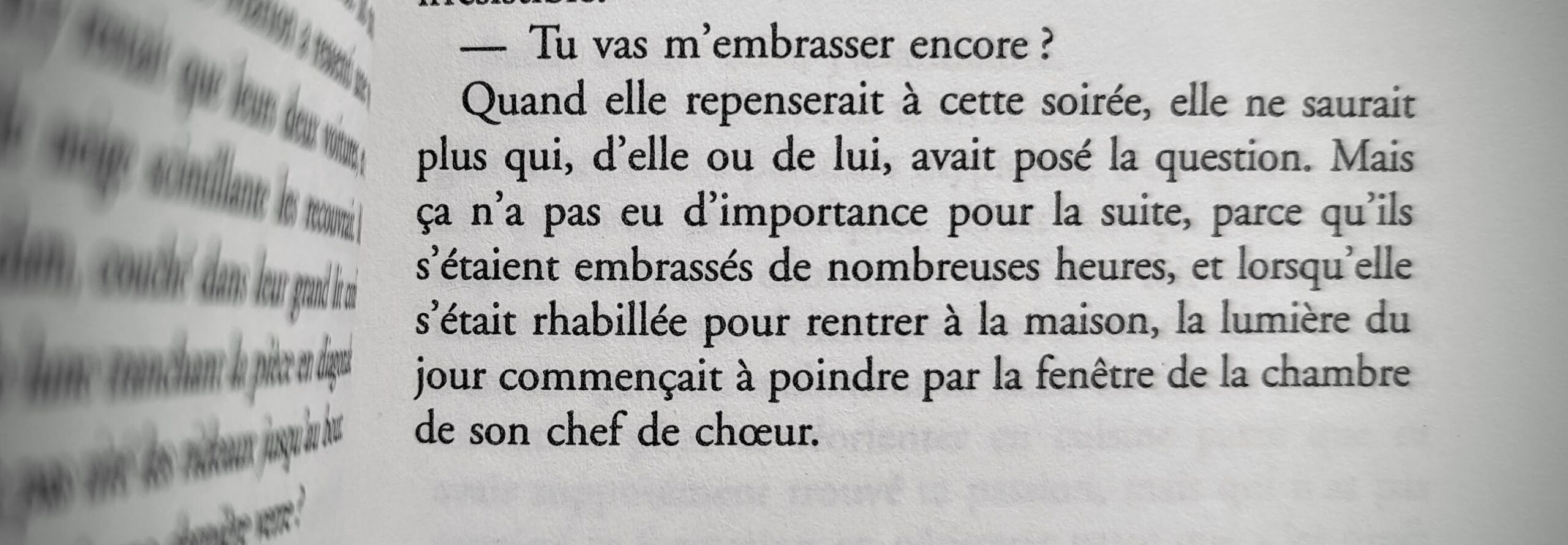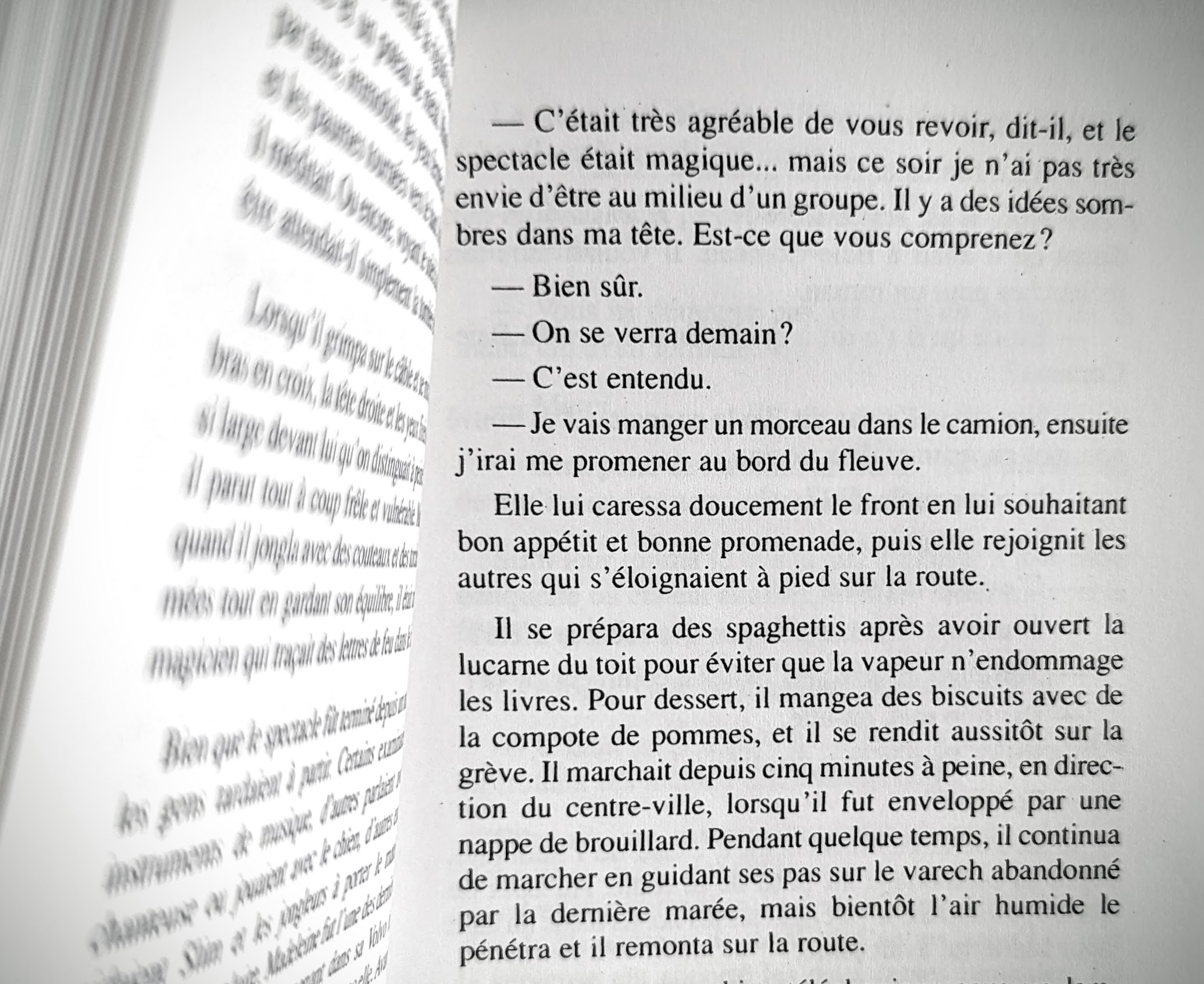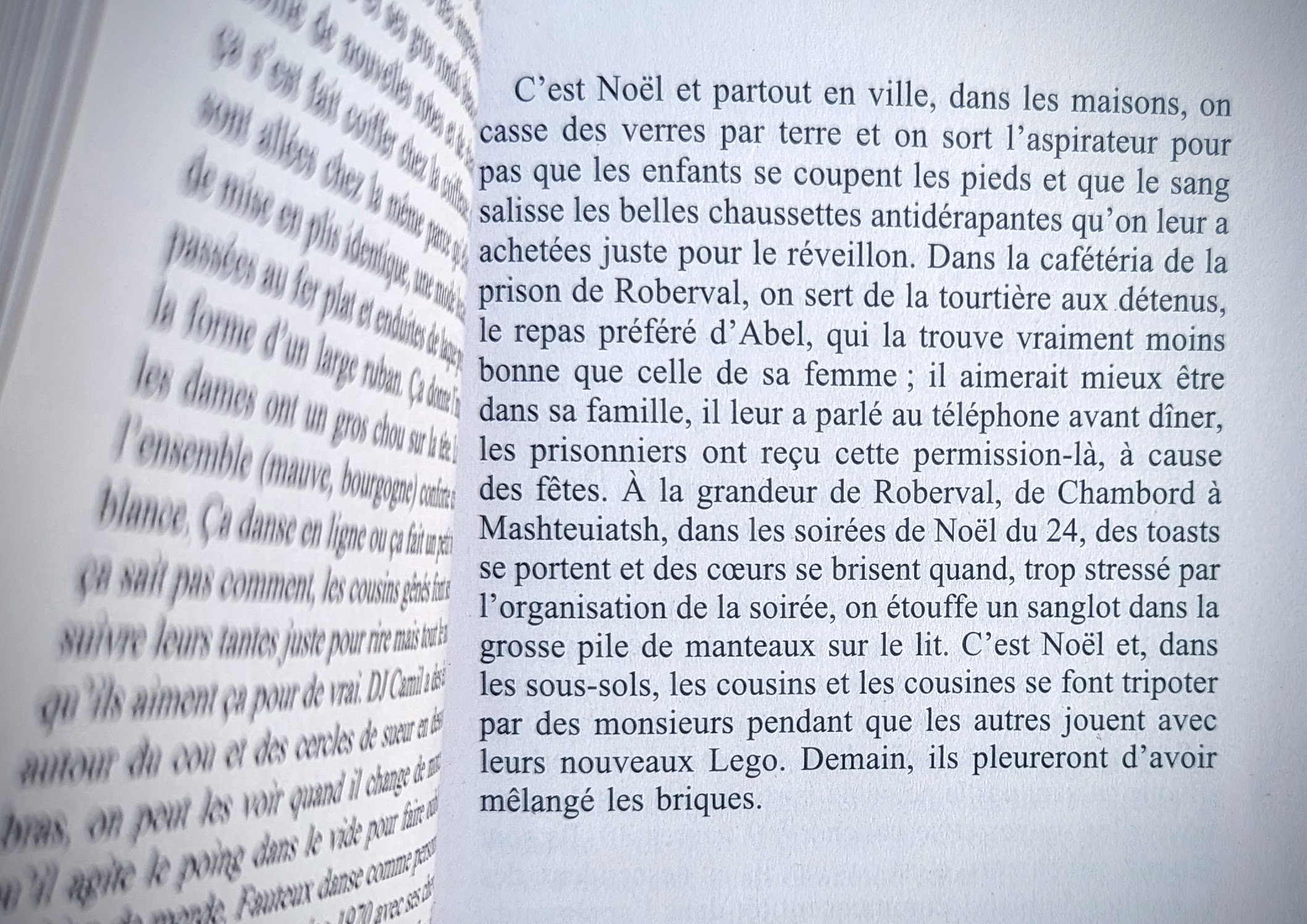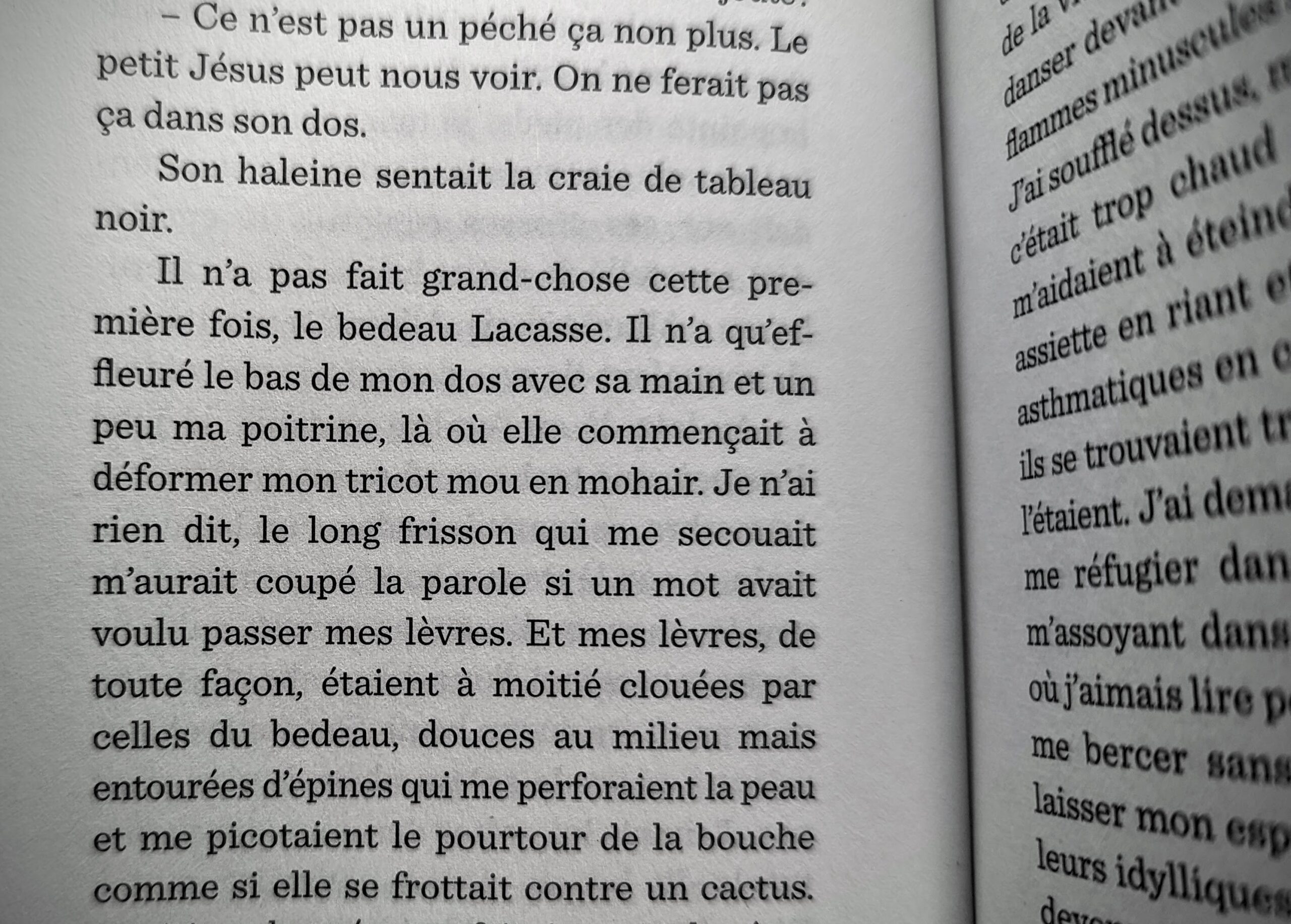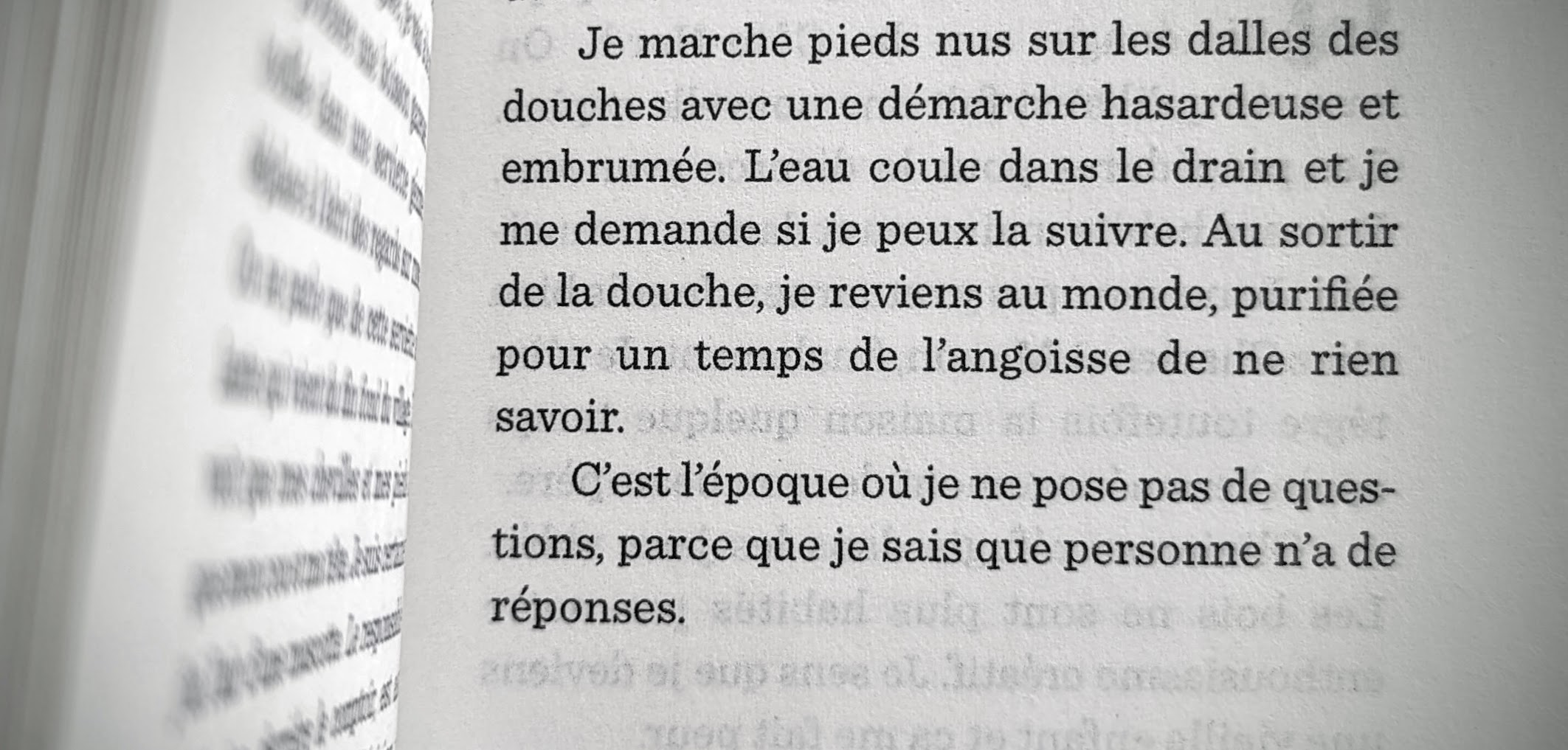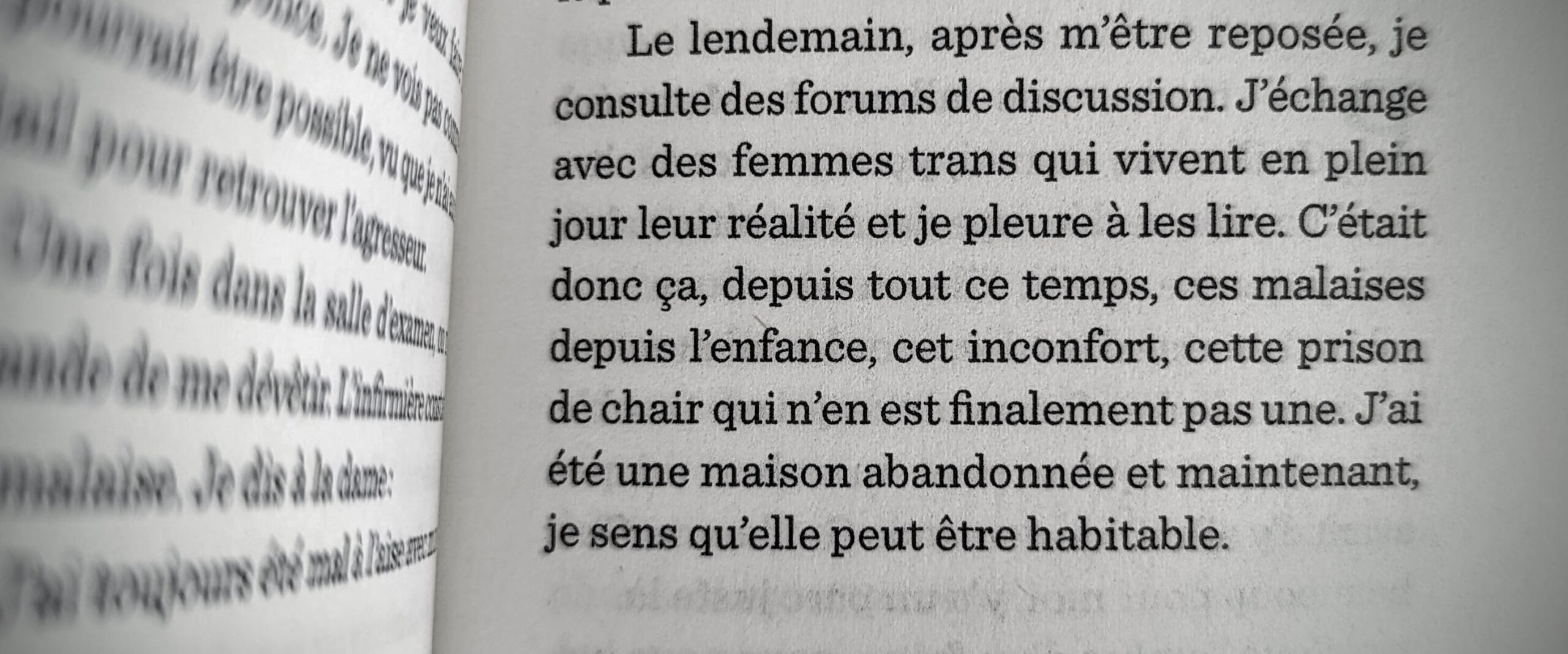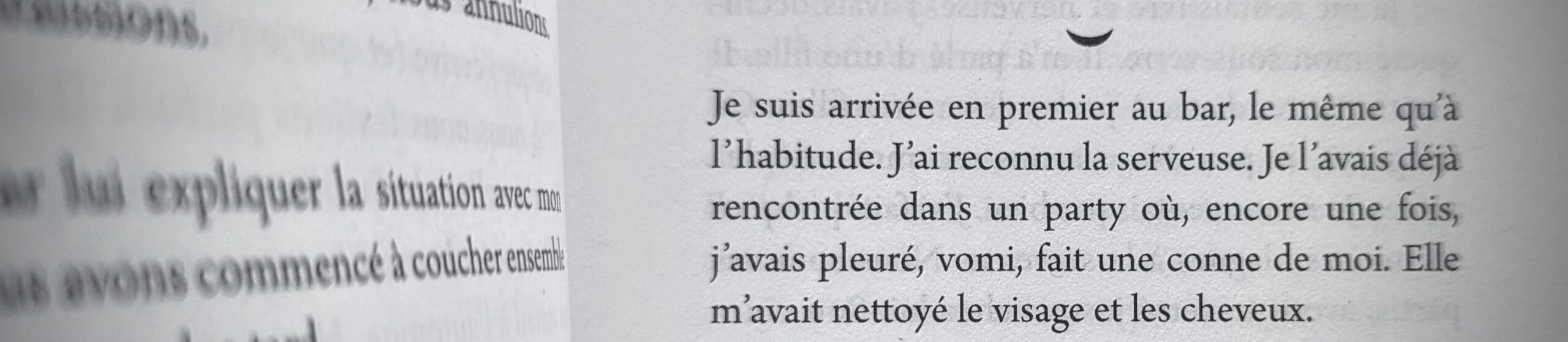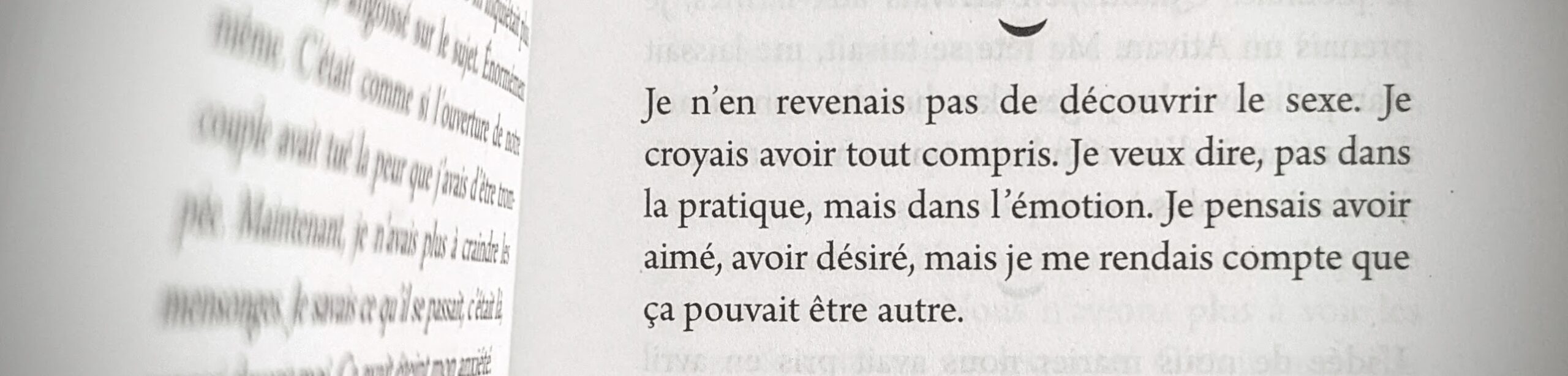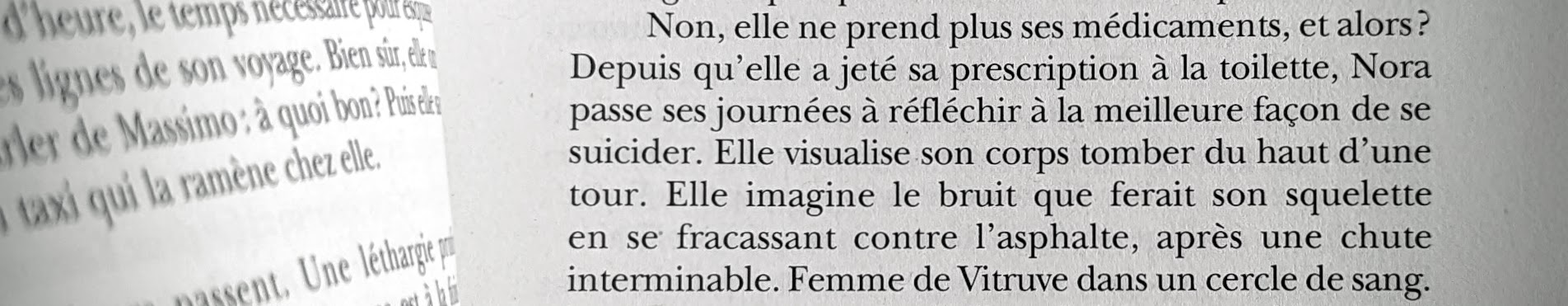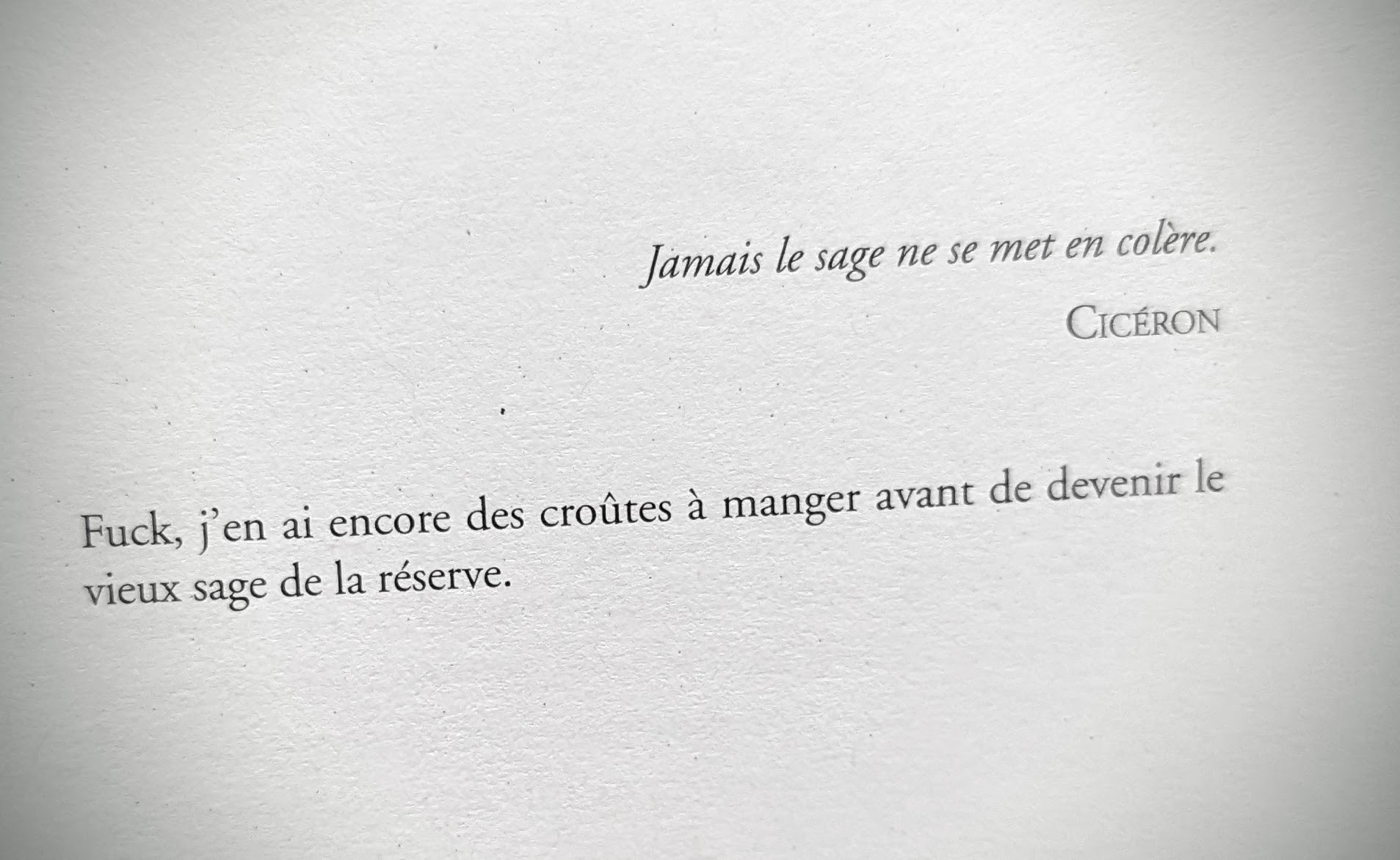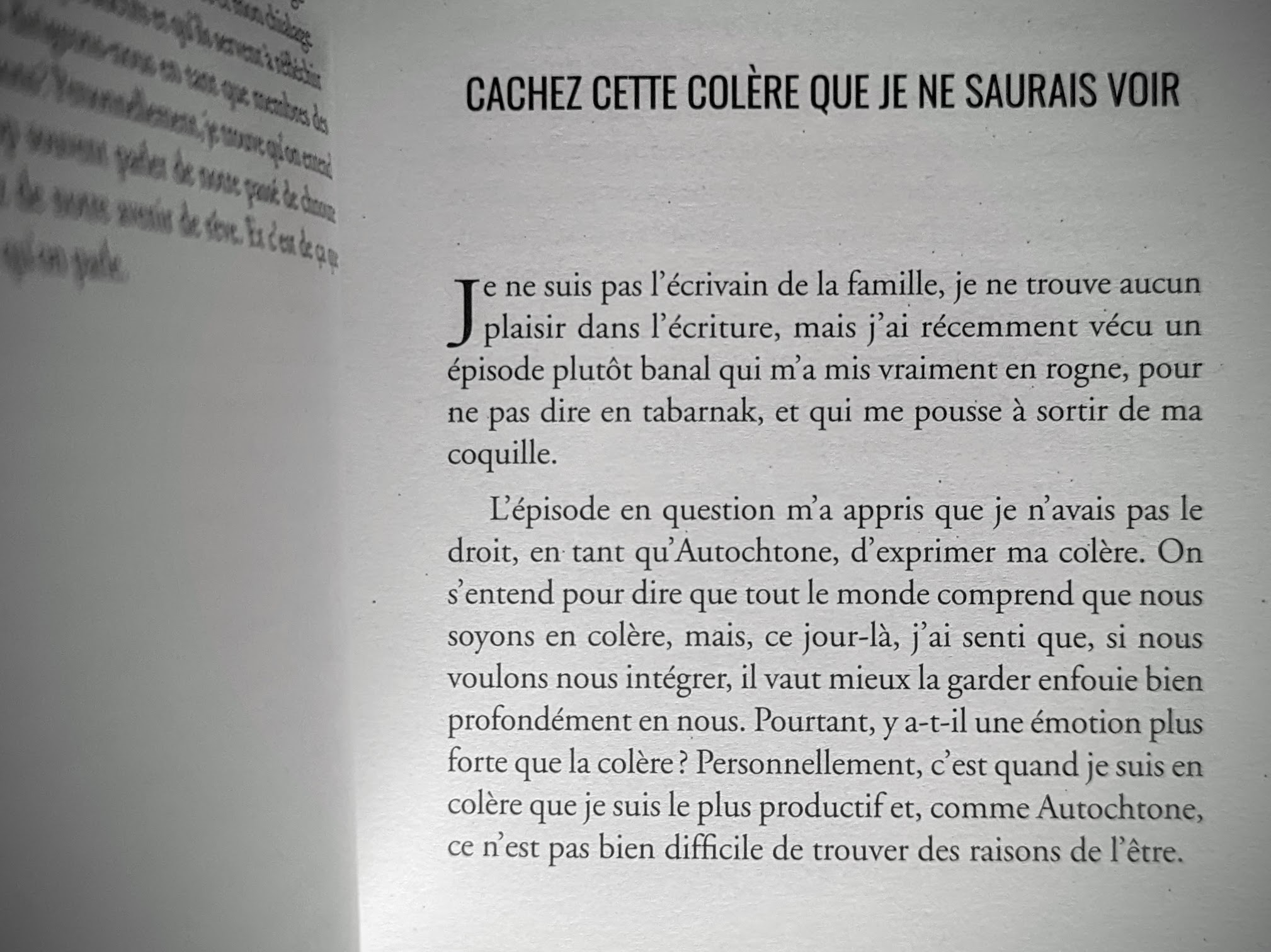Kukum m’a fait pleurer deux fois. Par la beauté des premiers instants et par l’horreur de la fin.

L’histoire de la grand-mère de l’auteur, Almanda Siméon née en 1882, qui épousa un jeune indien Innu. Une histoire d’amour magnifique au milieu du grand nord canadien. Une belle, très belle histoire qui aurait pu durer toujours.
Jusqu’à ce que Michel Jean nous rappelle brutalement à la réalité…
Et à l’annihilation de peuples premiers en détruisant les forêts, les lacs, la langue et les traditions par le « progrès », la sédentarisation, l’alcool, la langue, les pensionnats…
Un livre aussi beau que terrible
Et voilà que deux semaines après, je tombe sur cette info de Radio Canada :
Protection de l’enfance : l’APN confirme qu’Ottawa versera 48 G$ pour réformer le système.
Une mer au milieu des arbres. De l'eau à perte de vue, grise ou bleue selon les humeurs du ciel, traversée de courants glacés. Ce lac est à la fois beau et effrayant. Démesuré. Et la vie y est aussi fragile qu'ardente. Le soleil monte dans la brume du matin, mais le sable reste encore imprégné de la fraîcheur de la nuit. Depuis combien de temps suis-je assise face à Pekuakami?
Almanda a 15 ans quand elle tombe amoureuse de Thomas, jeune Innu de l'immense lac Pekuakami. Orpheline québécoise d'origine irlandaise, elle quitte les siens pour le suivre dans cette existence nomade, brisant bientôt les carcans imposés aux femmes autochtones pour apprendre la chasse et la pêche. Ancré dans une nature omniprésente, sublime et très vite menacée, son destin se mêle alors à celui, tragique, d'un peuple ancestral à la liberté entravée.